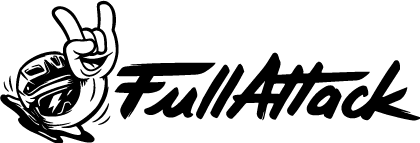À travers cet article particulier, Endurotribe propose aujourd’hui une autre méthode pour choisir ses pneus d’Enduro. Car souvent, le réflexe se porte sur ce qui se voit de manière évidente… Pourtant, tout n’est pas dans la gomme ou les crampons !
Notamment lorsqu’il s’agit de combattre ces foutues crevaisons et/ou sensations de pilotage étranges qui nous gâchent la vie ! Parfois, elles ne tiennent pourtant qu’à une négligence flagrante : ne pas se soucier de l’âme du pneu, la base d’un choix pertinent…
Les carcasses ! À travers ces essais comparatifs, Endurotribe braque donc les projecteurs sur ce qui se cache au coeur des pneus, en fait le caractère intrinsèque. En quoi consistent-elles ? Lesquelles pour quels usages ? Que valent celles du marché ? Comment les choisir ? Réponses !
Temps de lecture estimé : 12 minutes
Au sommaire de cet article :
- Un pneu, c’est quoi ?
- Approche particulière…
- De quelles carcasses parle-t-on ?
- Les recettes des manufacturiers ?
- Sur le terrain
- Première lecture
- Bien choisir ses carcasses
- Quelques bonnes astuces
- Question subsidiaire
- Que retenir ?!
Un pneu, c’est quoi ?!
Lorsque l’on cherche à définir ces éléments en contact avec le sol, deux éléments évidents viennent à l’esprit.
Le premier, appelé profil dans le jargon, définit la forme et la disposition des crampons sur le pneu. Leur étude est une science à elle seule, mais assez logiquement, les conclusions restent faciles à cerner : plus ils sont prononcés, plus il y a de chance d’avoir du grip, moins il y en a, que ça roule.
Le second porte sur les gommes : ces mélanges de composés, issus en bonne partie de l’industrie pétrochimique. Leurs présences, et leurs proportions, influent sur le comportement vis-à-vis du sol, en matière d’adhérence, d’usure, de rendement… On oppose bien souvent gomme dure et gomme tendre.
Tout ce beau monde prend place sur un support : la carcasse du pneu ! Elle se compose elle-même de différents éléments : des fils – tissés en nappes – eux mêmes noyés dans la gomme. L’ensemble supporte les tringles, à ses extrémités, en contact avec les crochets de jante.
Approche particulière…
En tant que squelette du pneu, la carcasse a son mot à dire dans le comportement de ce dernier. Après tout, c’est bien elle qui se déforme au contact des obstacles, s’affaisse sous les appuis du pilote, résiste aux agressions du terrain et s’assoie sur la jante ! En un sens, elle pose les fondations d’un bon pneu..!
C’est pourquoi cet article Endurotribe propose une approche différente des choix pneumatiques habituels : tenir compte de la carcasse en premier lieu, du moins comme facteur majeur et prépondérant. Pourquoi..?
Pour s’assurer de la robustesse en premier lieu ! Un pneu d’Enduro ne vaut rien s’il ne tient pas le choc… Pour être plus cohérent avec son propre vélo ! Certains cocktails cadre/roues/carcasses ne font pas bon ménage… Parce que les pneus sont des consommables, opportunité logique et financièrement abordable de jouer sur le comportement global du vélo…
Et pour compléter une vision parfois simpliste du marché ! On sait tous à quoi ressemble un Toro, un High Roller ou un Magic Mary, pourtant toutes leurs versions ne se prêtent pas à notre pratique fétiche…
De quelles carcasses parle-t-on ?!
En effet, certains de nos profils préférés sont déclinés sur différentes carcasses, dont il existe plusieurs types. Historiquement, l’Enduro a débuté à une époque où cohabitaient deux catégories : légères – moins de 750g/pneu – destinées au Cross Country (XC), et épaisses – plus de 1,2kg/pneu – destinées à la descente (DH). Les premières étaient bien trop fragiles, les secondes très lourdes.
Depuis, l’offre s’est enrichie. En premier lieu via les carcasses All Mountain (AM) : version renforcée – autour de 850g/pneu – des carcasses XC. On parle alors des Maxxis Exo, Schwalbe SnakeSkin, Michelin Trail Shield, Continental ProTection, Hutchinson Hardskin…
Jusqu’à il y a peu, restait un gap entre ces carcasses AM et les carcasses DH, que les derniers développements des manufacturiers ont fini par combler. Depuis quelques temps, une offre spécifique Enduro se niche dans cet espace : entre 900g et 1,1kg/pneu > un peu plus légère que les carcasses DH, un peu plus solides que les carcasses AM.
Cette enquête se consacre à ces carcasses Enduro (EN). On parle donc ici des Maxxis Double Down, Schwalbe Super Gravity, Michelin Reinforced, Specialized Grid 2 Bliss, Mavic XL, Continental ProTection Apex, Hutchinson Hardskin 2x66Tpi… Car si elles se positionnent sur le même créneau, chacune a sa manière de procéder !
Les recettes des manufacturiers ?!
Pour respecter le cahier des charges, chaque manufacturier joue sur la manière de composer sa carcasse Enduro.
En premier lieu, sur les fils qui composent la trame. La provenance de la matière peut varier de l’un à l’autre, mais chacun reste discret à ce sujet. La densité et la taille des fils ensuite, notée par un chiffre en Tpi. Plus ce dernier est petit, moins il y a de fils, mais plus ils sont gros, et costauds.
Sur la gomme en second lieu. Celle qui noie et lie les nappes de fils, mais aussi de renforts, placée à certains endroits stratégiques, comme les flancs notamment, pour éviter les pincements…Petit aperçu imagé de ce que chaque marque propose à ce sujet :
La lecture de ces premières informations en dit long sur les différences susceptibles d’être perçues sur le terrain. À n’en pas douter, les manufacturiers rivalisent d’ingéniosité pour proposer leur solution propre. Il est donc temps d’évoquer la pratique, pour en saisir les véritables comportements…
Sur le terrain…
Pour parvenir au tableau récapitulatif ci-dessous, 38 pneus répartis en une vingtaine de paires se sont succédés durant 6 mois, sur l’ensemble des vélos à l’essai Endurotribe : 10 paires de roues différentes réparties entre 27,5 et 29 pouces, Un Objectif Epic inclus. Au total, 120h de roulage effectif, 1500km parcourus sur 70 séances. Les notations que voici en sont l’extrême synthèse.
Pour chaque carcasse, la méthode est la même : définition de la pression minimale à laquelle le pneu peut fonctionner, puis de la pression idéale offrant le meilleur compromis parmi les critères d’appréciations. C’est une fois ce travail préliminaire effectué que certains paramètres, dont la solidité, la précision, l’amorti et la durabilité sont précisés…
Première lecture
Afin d’aider à la compréhension des résultats, en voici une première lecture. Critère par critère, elle permet de dégager les grandes tendances de l’offre…
- Robustesse > un trio de tête se dégage clairement. Maxxis / Schwalbe et Michelin sont les trois à présenter une solidité suffisante pour l’usage en compétition, avec marge de sécurité pour palier à quelques erreurs. Suivies de près par Specialized, pardonnant à peine moins. Sur ce terrain exigeant, Mavic, Hutchinson et Continental tiennent, mais ne pardonnent pas. Une pratique sportive, mais à un rythme moins soutenu, semble plus au coeur de leur cible.
- Montage > Au moment de monter les pneus, les carcasses Schwalbe et Maxxis semblent être un bon compromis ; ni trop lâches, ni trop serrées. Les Mavic et les Hutchinson aussi, peut-être plus élastiques, semblent assurer une bonne étanchéité sur jantes Tubeless et UST. En la matière, les Specialized sont assurément les plus ajustés, pas toujours facile à faire passer au dessus de certains crochets.
- Gonflage > comparativement, les Michelin sont les pneus que l’on peut rouler à la plus basse pression sans que leurs différentes qualités s’estompent. Les Schwalbe demande un poil plus d’air – 0,1 bars env. Les Maxxis et Specialized se défendent bien aussi sur ce point, tandis que les Mavic, Hutchinson et Continental demandent plus d’air – 0,25 bars env. – pour tenir les caractéristiques décrites ci-après.
- Sensibilité > Les Michelin sont clairement les pneus les moins exigeants en matière d’ajustement de la pression. 0,1 ou 0,2 bars de différence à l’intérieur n’a clairement pas la même influence que sur les Mavic ou certains Hutchinson, plus sensibles. Le comportement de ces derniers est bien plus sensible à la pression.
- Stabilité > Les Michelin offrent un amorti incomparable. Pour ordre d’idée, à pression optimale, leur usage peut représenter l’équivalent de 2 à 3 clics de détente en plus ou en moins vis-à-vis des Mavic ou certains Hutchinson qui rebondissent et dynamisent plus. À noter que la tendance est tout de même à ce que ces carcasses Enduro amortissent.
- Placement > Lorsqu’il faut se faufiler entre les obstacles, deux écoles s’opposent. Les Michelin, les Specialized et Continental misent plutôt sur la précision, pour assurer au pilote qu’il puisse placer sa roue où il le souhaite. En la matière, les Schwalbe se montrent un peu moins exigeants. Si l’équilibre et le placement du pilote n’est pas parfait, le pneu semble moins contraint, et perd moins vite ses bonnes caractéristiques.
- Toucher > Au contact des aspérités, les Continental donnent sensiblement l’impression que la carcasse se comporte comme une matière cartonnée, rigide mais qui plie par endroit. Très certainement dû à la grande proportion de fil, et faible usage de gomme, dans leur composition. À l’extrême opposé, les Mavic donnent le sentiment de se déformer et d’épouser le terrain comme le ferait un ballon de baudruche.
- Maintien > Sur l’angle, les carcasses Schwalbe soutiennent particulièrement bien leurs crampons latéraux. De plus en plus au fur et à mesure que l’on force l’appuis. À l’opposé, les Mavic laissent le pneu prendre de l’angle et offrent toujours le même maintien sans supplément. Des comportements que l’on constate en accord avec la présence de renfort et le nombre de plis présents dans les flancs, vis-à-vis de la bande de roulement…
- Rendement > À la relance, les Mavic offrent clairement la plus faible impression d’inertie du panel essayé. Le résultat est très proche de certaines carcasses AM telles que des Maxxis EXO WT ou Michelin Trail Shield. À l’opposé, les Michelin et Schwalbe nécessitent de jouer sur le profil des crampons pour conserver un bon rendement au train.
- Constance > Attention, ce critère ne signifie pas la vitesse d’usure de la gomme ou des crampons, mais bien si la carcasse garde ses traits de comportement dans le temps. Sur ce plan, Michelin et Specialized offrent les carcasses qui gardent leur propriétés le plus longtemps au cours de la durée de vie du pneu.

Bien choisir ses carcasses…
L’ordre des critères au sein du tableau n’est pas anodin. S’impose en premier lieu la robustesse des carcasses. Les plus fins et/ou non-compétiteurs sont chanceux, ils peuvent envisager toutes les montes de ce comparatif. Les plus costauds et/ou compétiteurs réduiront leur spectre en fonction de leur attentes, et de leur propres expériences passées.
Passé ce filtre, on se penche sur les autres paramètres. Montage, pression et sensibilité permettent surtout de conclure sur la facilité d’usage des carcasses. Certains ont certainement des attentes ou des habitudes en la matière : jantes aux crochets hauts, usage ou non du manomètre électronique à chaque sortie…
Viennent ensuite les critères plus subjectifs de comportement. En la matière, choisir une carcasse est une question de compromis. Il faut donc prioriser ses attentes. On peut tout de même identifier certains cas de figure particuliers, pour lesquels le choix de carcasse est très à propos…
Quelques bonnes astuces…
– 1er cas de figure : le pneu qui s’affaisse sous l’appui à pression offrant le bon grip, mais qui perd ses qualités lorsqu’il est suffisamment gonflé > Opter pour une carcasse plus précise. À savoir aussi que très globalement, les carcasses Enduro se tiennent mieux que les carcasses AM à pression équivalente.
– 2ème cas de figure : vélo (poste de pilotage/cadre/fourche/roues) très rigide, ne pardonnant pas l’erreur de trajectoire ou d’équilibre, très « tape cul » malgré des réglages de suspensions très souples > Opter pour une carcasse qui amortit un peu plus, qui est plus tolérante, et/ou qui a un comportement un peu plus élastique peut adoucir le tableau. Attention cependant à ne pas opter pour l’extrême opposé de la monte originale : sur roues très raides, carcasses très tolérantes et élastiques vont tout prendre, et se dérober.
– 3ème cas de figure : vélo (poste de pilotage/cadre/fourche/roues) très mou, ne permettant pas de placer sa roue où souhaité > logique inverse, opter pour carcasses plus précises. Attention ici aussi à ne pas opter pour l’extrême opposé, qui risque juste de sur-solliciter roues et cadre sans régler le problème.
– 4ème cas de figure : vélo à l’assiette instable et au rendu inconfortable sur terrain défoncé malgré réglages de suspensions optimisés et/ou en limite de plages de réglage > opter pour carcasses à l’amorti plus prononcé, susceptible d’apporter l’équivalent des 2 à 3 clics de frein en détente évoqués précédemment.
Question subsidiaire…
Doit-on monter les mêmes carcasses à l’avant et à l’arrière ?! L’expérience de ces longues heures d’essai me pousse à dire oui en première intention. Sauf cas exceptionnels, c’est ainsi que l’on obtient les résultats les plus cohérents en matière de robustesse, d’assiette, d’équilibre et de précision.
On voit parfois des choix particuliers en compétition : un mix de carcasse entre AM, EN et DH, afin de jouer une version particulière du compromis robustesse/rendement. Reste que ces solutions peuvent avoir un impact sur l’équilibre du vélo que seuls ceux qui maîtrisent leurs suspensions savent compenser par quelques clics bien sentis.
Edit du 21/06 > Cette initiative de carcasses différenciée peut effectivement avoir un intérêt dans certaines configurations où l’intensité des appuis devient très/trop différente entre avant et arrière. Dans ce cas, raideurs différentes peuvent s’imposer. On pense notamment à plus costaud à l’arrière, pour affronter les pires appuis…
Dans tous les cas, l’expérience démontre que le rendu peut devenir contre-productif lorsque l’on ose mixer deux carcasses aux caractères très opposés en matière d’amorti, de précision et de maintien sur l’angle.
Que retenir ?
Si cette enquête va loin dans les détails concernant les différentes carcasses Enduro du marché, la méthode et les enseignements à en tirer reste relativement simples.
En premier lieu, considérer que l’offre actuelle occupe bien l’écart entre carcasses AM et DH. Les pneus Mavic XL, Hutchinson HardSkin 2×66 et Continental ProTection Apex étant les plus proches des premières, les pneus Schwalbe et Michelin étant les plus proches des secondes.
Choisir les bonnes carcasses implique donc de se positionner à deux échelles. En premier lieu définir le type de carcasse que l’on ambitionne (XC/AM/EN/DH) en fonction du ratio rendement/robustesse que l’on exige. Si l’offre Enduro l’emporte, choisir la marque de ses carcasses en fonction du terrain, du style de pilotage, des conditions et de l’impact que l’on souhaite avoir sur le comportement du vélo.
C’est alors que l’on joue sur les profils et gommes disponibles : plutôt tendre et cramponné à l’avant pour le grip, dure et roulant à l’arrière pour le rendement… Même si là aussi, des astuces et ajustements existent. On s’écarte du sujet, mais après tout, il en ferait un bon pour une prochaine publication ! À bientôt ?! 😉
Edit du 30/06/2017
Détail des pneus utilisés
Schwalbe : Magic Mary, Hans Dampf, Rock Razor
Michelin : Wild Grip’R, Wild Rock’R2, Wild Race’R Enduro Rear
Maxxis : Agressor, High Roller II, Minion DHF, Tomahawk
Specialized : Butcher, Slaughter, HillBilly
Mavic : Claw Pro XL, Charger Pro XL, Quest Pro XL
Hutchinson : Toro, Squale, Taïpan
Continental : Der Baron Projekt, Der Kaiser, Trail King